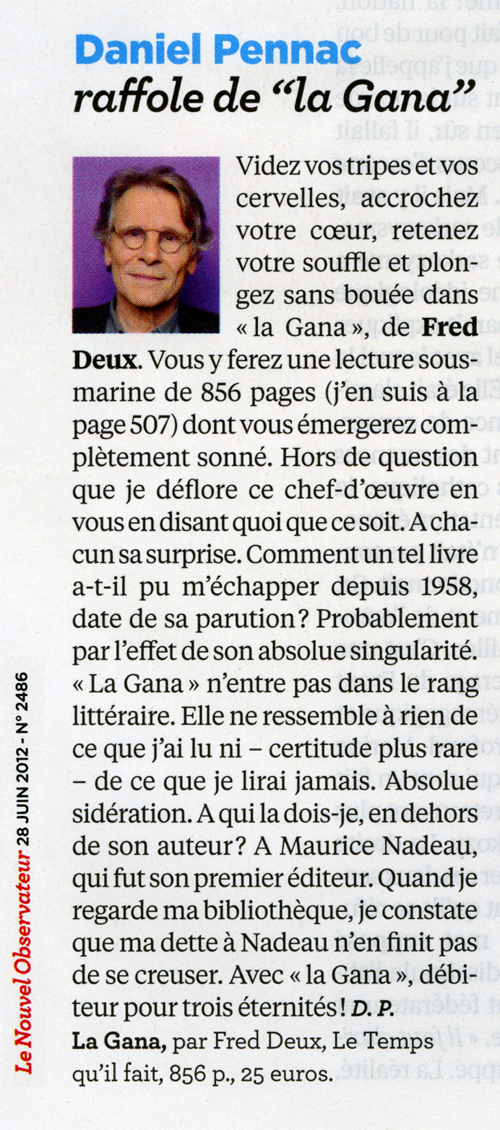Parution Octobre 2011 • Réimpression Janvier 2020
.jpg)
Fred Deux
(Jean Douassot)
La Gana
Préface de Maurice Nadeau
Coll. Corps neuf, 5
2011. 860 p. 12/18.
ISBN 978.2.86853.555.9
25,00 €
Le livre
S’il est pénible d’entrer dans ce livre, il n’est pas non plus facile d’en sortir. L’auteur nous a subjugués, envoûtés, et, au vrai, je le dis sans goût pour les paradoxes faciles, c’est peu de huit cents pages pour parvenir à un tel résultat. D’autres n’y seraient pas parvenus en trois mille, et beaucoup par leur œuvre entier. Jean Douassot a découvert une planète que nous pensions connaître: le monde du sexe et de l’organique, ou le monde réduit à ses soubassements sexuels et organiques, alors que nous en ignorions la minutieuse topographie. Pour dresser celle-ci il fallait sans doute un géographe, il fallait surtout un poète pour conduire le géographe. L’auteur s’est laissé mener par l’enfant qu’il a sans doute été et c’est pourquoi La Gana baigne tout entière dans cette poésie cruelle et violente qui est celle de l’enfance aux prises avec des mystères trop grands pour elle. Cette poésie transforme le sordide en objet d’art. Elle permet de substituer au dégoût ou à l’apitoiement facile la révolte. Elle entraîne un ouvrage qui aurait pu n’être que remarquable, et en marge, dans les grandes eaux d’une littérature qui aide à vivre.
(Maurice Nadeau, extrait de la préface)
L’auteur
Fred Deux est né en 1924, et a vécu les trente dernières années de sa vie dans une petite ville du Berry où il est mort le 9 septembre 2015. Dans la solitude de l’atelier et dans un temps non linéaire, se consacrant tout ensemble au dessin, à l’écriture et à la parole (enregistrée sur magnétophone), il a construit — par ces trois moyens inséparables — une œuvre entièrement vouée à l’introspection, par nature éloignée des courants esthétiques de l’époque. Le cycle autobiographique publié sous le pseudonyme de Jean Douassot — La Gana (1958), Sens inverse (1963), La Perruque (1969), publiés par Maurice Nadeau, et Nœud coulant (1971), publié par Éric Losfeld — lui a conquis un cercle de lecteurs fervents. De Gris (1978) à Entrée de secours (Le temps qu’il fait, 2007), il poursuivit ensuite sous son nom, comme dans son œuvre graphique, la publication de livres où, dépassant «l’autobiographie lardée de rêves», il nous montre des voies possibles pour conjurer la réalité et sortir de soi-même.
Extrait
Plaque de fonte
Le centre de notre pièce était signalé par une plaque de fonte. De ces plaques qu’on trouve sur les trottoirs. Vulgaire plaque d’égout noire et quadrillée. Un trou carré devant servir à la soulever. Cette plaque servait entre autres de point de repère pour y placer notre table ronde. Elle était cachée par la toile cirée qui pendait très bas. Le père avait bouché le trou du centre de cette plaque car il arrivait assez souvent en hiver, à la période des crues ou décrues, que des odeurs extrêmement violentes se faufilent par là et nous empoisonnent. Nous entendions aussi, pendant les mêmes périodes, l’eau couler au-dessous à gros bouillons.
La nuit, en me réveillant, j’avais toujours une peur intense en entendant ces bruits. Le trou dans mon volet et cette plaque hantaient mes rêves et mes insomnies. Le couloir qu’il fallait longer pour arriver à la porte de la pièce, venant de l’entrée de l’immeuble, était également déprimant. Mais rien n’atteignait l’angoisse dans laquelle me plongeait cette plaque de fonte. Pendant les crises de ma mère, il lui arrivait de menacer de l’ouvrir, c’est-à-dire de la lever et de descendre dans le trou. De disparaître. J’évitais soigneusement de passer dessus. J’avais toujours l’impression qu’elle allait se briser et que je disparaîtrais dans le gargouillis. Les rares copains que j’avais et qui venaient étaient aussi angoissés par elle. Il arrivait que, jouant, le jouet aille se placer sur cette plaque. Je traversais à certains moments de telles frayeurs que, pour le retirer, je prenais un balai et je poussais le jouet hors de ce cercle.
Gargouillis qui me réveillaient et me tenaient en éveil. Je m’agitais souvent dès le coucher ayant entendu mon vieux parler d’eau qui montait dans la rue du Port. Je me couchais en me promettant de ne pas fermer l’œil de la nuit. Naturellement je sombrais toujours dans le sommeil et, si la chance était avec moi, j’y sombrais jusqu’au matin. Souvent, au contraire, une telle agitation m’éveillait. Je rêvais presque toutes les nuits que l’eau montait, qu’elle soulevait la plaque et que, me penchant, je touchais l’eau sous mon lit. J’appelais alors la grand-mère et je ne la trouvais pas. La pièce était éclairée faiblement et, debout sur mon lit, je regardais vers le sien. La grand-mère n’y était plus. Je m’affolais, sautais, je n’osais pas regarder la plaque sous la table.
J’inspectais la pièce : de grand-mère nulle part, et l’eau noire qui montait. Je voulais crier et je ne le pouvais pas.
Regardant avec une peur atroce vers la plaque, j’apercevais alors la grand-mère dans le trou, la tête émergeant. Morte.
Je hurlais et je m’éveillais. Quelquefois, la grand-mère, m’entendant m’agiter, me secouait. Je sortais alors de mon cauchemar, regardant la plaque. Rien de semblable. Elle fermait bien, la table était dessus, la toile cirée descendait très bas. La grand-mère était dans son lit.
Elle éteignait sa lumière et me conseillait de redormir. Impossible de retrouver le calme. Je tourne dans mon lit, je tends l’oreille. L’eau ! J’entends l’eau. J’ouvre les yeux dans le noir. Je laisse glisser ma main, j’arrive au ciment. Il est glacé. Je le prends pour de l’eau, Je retire ma main puis, m’apercevant qu’elle n’est pas mouillée, je recommence. J’ai peur. Je touche le ciment une nouvelle fois. Sec.
Je repars doucement dans le sommeil. Tout se brouille. Rêve et éveil. Je ne sais plus si je suis éveillé. Je cherche des points de repère. Je cherche de quoi me rassurer. Ou bien je guette ce qui est trop invraisemblable. Premier essai, le volet. Je me penche sur mon lit, je regarde en l’air. J’ai perdu tout sens de l’orientation. Je ne sais plus où est le volet, si le trou est en haut ou en bas. De plus, j’ai le sentiment d’être tourné la tête aux pieds. Rien n’est normal. Je rêve. Je dois rêver. Je baisse ma main, je touche le ciment. Je me passe la main sur le front, je sens que c’est collant. Je vois très clair dans la pièce. Ma mère fait le café. Je suis heureux. J’ai envie de pisser. Ma mère se retourne et m’apporte à boire. Je suis envahi par la joie. La nuit est finie. Enfin. Si mes parents voulaient, je coucherais bien avec eux, dans leur loge de gardiens. L’eau ne montera jamais si haut. La mère me tend mon bol. Je bois et je renverse tout. La lumière disparaît. L’ombre revient. Le volet est ouvert, je vois le ciel. J’entends dans le couloir marcher, frotter. Je touche mon front. L’eau perle. L’eau, l’eau. Je plonge ma main, je tombe, je nage. C’est glacé. Je tremble dans l’eau. Je me fais vite à son contact et n’ai qu’une pensée : ne pas me laisser entraîner vers le milieu de la plaque. La pièce est pleine d’eau. Le buffet flotte, couché. La table se décolle. Le feu ronfle sous l’eau noire. J’ai peur aussi de me brûler. Je dois dormir. Je devrais crier. Si je criais, la grand-mère me réveillerait.
Je crie mais l’eau entre. Je ne crierai plus. Et l’oncle, est-ce qu’il ne viendra pas m’aider ? Où est la grand-mère? J’approche de la plaque, l’eau est transparente par endroits, très boueuse en d’autres. Là où se trouve la plaque, il y a comme un tourbillon. Je suis irrésistiblement entraîné vers lui. Je vais partir. Au secours ! Au secours !
Je suis sans doute réveillé puisque je suis dans mon lit. Je regarde le volet, cette fois il est à sa place. Le trou aussi et l’eau ne coule pas. Je tends l’oreille, le couloir est silencieux. La grand-mère ronfle, le feu est éteint. Tout est normal. Je souris dans mon lit.
J’allonge les pieds, je suis glacé, et tire les couvertures. Une seule solution : dormir sous le paquet de draps, de couvrantes, d’édredon. Je me planque, je m’enferme le plus hermétiquement possible, je me borde dans mon lit, le corps enroulé, fermé, en chien de fusil. J’ai la tête dans les bras. Serrée sur ma poitrine. Les genoux rapprochés sous le ventre, la bite coincée, je respire difficilement mais je me sens en sécurité. J’ai chaud mais je préfère étouffer plutôt que de voir ce que j’ai vu. Qu’ai-je vu ? L’eau ? Il n’y en avait pas, la grand-mère ne flottait pas. J’ai rêvé. Sous mes draps, je regarde vers le volet. Je sais qu’il est dans cette direction-là. Je vois le trou à travers ma carapace. C’est pas possible. Je ferme les yeux, les rouvre. Je vois distinctement le trou du volet. Je sors la tête de mes couvrantes, je regarde le trou. Pas de trou. Je tourne la tête à gauche, je vois le trou illuminé. Une fois encore je plonge sous tout mon tas, je vois le trou. Partout ce trou.